
« Le Saint Graal de l'électrique ? » : Rivian remet en question l'avenir des batteries solides
2025-09-01
Auteur: Philippe
Des avancées notables, mais des défis persistants
Les batteries de voitures électriques ont connu des progrès remarquables ces dernières années, devenant à la fois plus performantes et plus abordables. Cependant, chez Rivian, l’un des constructeurs américains les plus en vue, la stratégie relative aux batteries reste un sujet de préoccupation majeur. R.J. Scaringe, le PDG de l’entreprise, a récemment exposé sa vision lors du podcast "Plugged-In", soulignant les défis techniques actuels et les technologies qui façonneront l'avenir de l'électromobilité.
Charge rapide vs. autonomie : un dilemme technique
L'approche de Rivian se distingue nettement de celle de ses concurrents, notamment sur l'équilibre délicat entre la vitesse de charge et la densité énergétique des batteries. Ce dilemme, souvent méconnu du grand public, représente un enjeu crucial pour rendre les véhicules électriques plus accessibles, en particulier pour les trajets longue distance.
Scaringe met en avant un paradoxe fondamental : améliorer la vitesse de charge se fait généralement aux dépens de la densité énergétique. Cela explique pourquoi de nombreux véhicules électriques aux États-Unis nécessitent encore entre 20 et 40 minutes pour effectuer une charge conséquente sur des bornes publiques. Bien que le constructeur chinois BYD ait fait sensation avec ses modèles acceptant jusqu'à 1000 kW de puissance, ces véhicules souffrent d’une autonomie limitée.
Les enjeux environnementaux et économiques des batteries
Cette problématique va plus loin. Une augmentation substantielle de la capacité de charge rapide a un impact direct sur la durabilité des cellules. D’après Scaringe, une charge excessive peut entraîner une perte de 20 à 25 % de la capacité originale après seulement 1000 cycles, générant ainsi un coût économique et environnemental considérable, car les batteries constituent la partie la plus coûteuse d’un véhicule électrique.
Innovations et économies chez Rivian
Pour surmonter ces défis, Rivian envisage plusieurs pistes d’amélioration. L'entreprise explore des modifications chimiques, notamment l'utilisation d'anodes en silicium pour optimiser la charge rapide. En parallèle, des améliorations dans les méthodes d'assemblage visent à réduire significativement les coûts de production.
Le futur crossover R2 de Rivian illustre parfaitement cette stratégie. Conçu avec des cellules de batterie plus grandes que celles de ses prédécesseurs R1S et R1T, ce modèle adopte une architecture monocouche qui réduit considérablement les coûts tout en intégrant la batterie dans la structure du véhicule.
Scepticisme envers les batteries solides
Contrairement à l'enthousiasme général autour des batteries solides, souvent présentées comme le Saint Graal de l'industrie, Scaringe se montre plus prudent. Il juge que le bruit entourant leur maturité commerciale est exagéré. Malgré des années de recherche, aucune production en grande échelle n’a encore été réalisée.
Vers un futur avec des technologies éprouvées
L'équipe de Rivian souligne que toute nouvelle technologie de batterie doit être fiable et massivement produite pour être pertinente. Ainsi, la société se concentre principalement sur l'optimisation des chimies existantes, notamment les cellules à haute teneur en nickel et les batteries lithium-fer-phosphate (LFP), appréciées pour leur robustesse et leur coût réduit.
Cependant, un obstacle majeur à l'adoption des batteries LFP aux États-Unis réside dans les tensions commerciales avec la Chine, qui contrôle presque entièrement l’approvisionnement global de cette technologie. Scaringe fait remarquer que la pénétration des LFP aux États-Unis est très limitée, un état de fait qui risque de persister sans changements dans la politique commerciale.
Face à cette réalité géopolitique, les constructeurs américains comme Rivian sont contraints d'innover localement pour se démarquer, transformant cette contrainte en une opportunité d'explorer des technologies avancées.

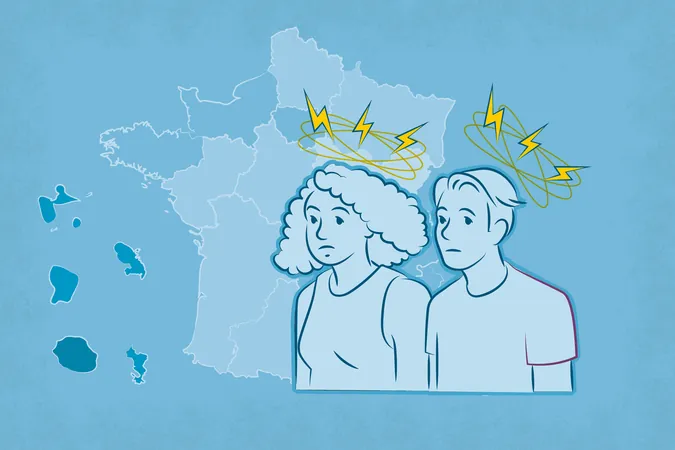



 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)